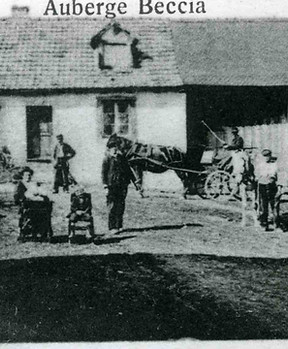A Bellefontaine, l'association NDBF vous ouvre une porte vers Dieu et vers l'avenir
L'ermitage
Les ermites, en principe des religieux, se sont toujours attaché à vivre seuls et dissimulés aux regards des habitants des agglomérations.
Souvent un ermitage était placé à côté des lieux de pèlerinage extérieurs aux localités, comme à Grünenwald par exemple.
Ici, l’assiette de la chapelle répondait donc à cette condition.
Ainsi en 1752, la garde en fut confiée à un frère, Jacques Fraiche (Bairel écrit que son nom pourrait être Fritsch), membre du Tiers Ordre et originaire de Vicques (près de Delémont, en Suisse).
C'est un document de 1769 qui nous donne cette indication en précisant qu'il résida tout d'abord, pendant près de 12 ans, à Reppe chez des habitants du village : les règles de solitude avaient donc déjà été enfreintes.
La même année, le curé de Reppe et de Phaffans confirmait dans son registre que cet ermite fréquentait les offices à Reppe.
Puis le curé Hürt de Traubach l'investit dans les fonctions de sacristain et lui permit de s'installer dans l’ermitage élevé à cet effet près du petit sanctuaire.
Une liste des ermites du Décanat de Masevaux, parue en 1775, nous renseigne également sur l’occupation de Bellefontaine à ce moment-là.
L'ermite Nicolas Joseph Quittard vivait alors avec le frère Jacob Riot 'profes démissionnaire'.
On a aussi connaissance d'une requête adressée par ces deux frères, conjointement, à l'évêque de Bâle, diocèse auquel appartenait le Sundgau (ceci jusqu’en 1790), afin d'obtenir des préceptes, s'inspirant de ceux de l'anachorète de Grünenwald.
En principe, tous les ermites du lieu ont joui d'une bonne réputation et d'après ce qu'en ont rapporté les habitants, les Frères Quittard et Riot ont tout particulièrement donné le bon exemple aux communautés rurales environnantes.
En consultant le traité des règles des frères de Grünenwald qui vraisemblablement devait s'appliquer à ceux de Bellefontaine, on apprend entre autres :
- que le frère devait remettre au curé toutes les clefs de son ermitage et … des meubles qui s'y trouvaient, pour lui permettre d'exercer un contrôle, quand bon lui semblerait ;
- que l'ermite ne pouvait s'éloigner qu'avec l'assentiment du curé ;
- qu'il devait ouvrir et fermer la chapelle à des heures déterminées, servir aux offices, tenir le petit sanctuaire dans un état de propreté constante, remplir le rôle de sacristain, se soucier de la décoration des autels, particulièrement aux fêtes de la Vierge.
En somme, il était responsable de la surveillance et du bon entretien de la chapelle.
Afin d’être un sujet d'édification pour tous, il devait assister à tous les offices dans l'église de sa paroisse, recevoir régulièrement la sainte communion, se distinguer par une vie exemplaire d'humilité, de pureté, d'obéissance et de pauvreté, de prière et de pénitence.
Ces anachorètes éprouvaient, parait-il, bien des difficultés à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Ils y parvenaient avec peine par des dons et aumônes ainsi que par l'exercice d’une petite culture ou par l'entretien d'un petit jardin attenant.
Ils étaient probablement vêtus d'une longue bure, avec, lorsqu'ils sortaient de leur enceinte pour aller quémander, un bâton de pèlerin et un chapelet.
Une maison que l’on a de tous temps qualifiée de vétuste, sans étage, constituait leur habitation.
Reconstruite de façon plutôt rudimentaire après la Révolution qui avait vu sa destruction, elle subsista néanmoins jusqu'à la première Guerre Mondiale.
Cette masure qui, d'après toutes les descriptions verbales des anciens, avait vilain aspect, se trouvait sur le terre-plein qui servit, postérieurement à sa disparition, à la célébration des offices en plein air.
C'est du mot Bruder (frère en allemand) qu'est dérivé l'un des surnoms (il y en eu un autre que nous verrons ultérieurement) du complexe de Bellefontaine : la 'Brouderie', terme que l'on employait très souvent, en particulier en patois roman, très en vogue jusque dans les années 1930.
-
Histoire de la Chapelle
-
Une porte vers Dieu et vers l'avenir
-
Naissance et renaissances
-
Origine de cette dévotion
-
Une histoire mouvementée
-
L'ermitage
-
La Révolution
-
La période post-révolutionnaire
-
Les deux guerres de 1870 et de 1914
-
"Natsi", le dernier des "frères"
-
Misère et apogée
-
La guerre 1939 - 1945
-
Témoignage de Raymond DURLIAT
-
Message de René PIERRE
-
Testament de l'Abbé Clavey
-
Les propriétaires successifs
-
Bibliographie
Accès direct
aux chapitres